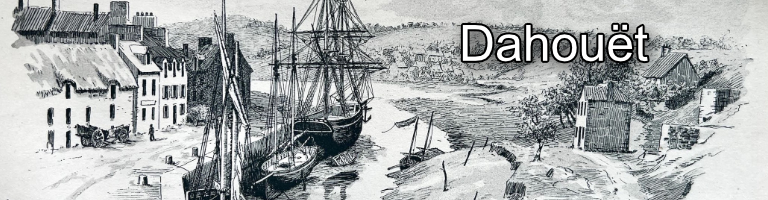
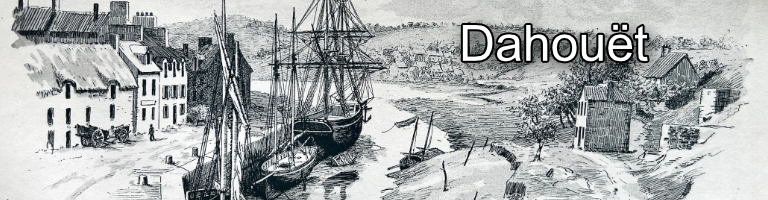
Portraits
Marins remarquables de Dahouët
Petit port de la côte nord de la Bretagne, Dahouët a vu naître toute une série de marins remarquables dont il nous a paru important de retracer le parcours de vie, parce qu'il nous rappelle la dure réalité que ces hommes ont dû affronter et les épreuves, insurmontables, qu'ils ont su surmonter. Un des plus remarquables est sans aucun doute Alexandre Lévêque.
Cliquez sur le lien ci-dessous